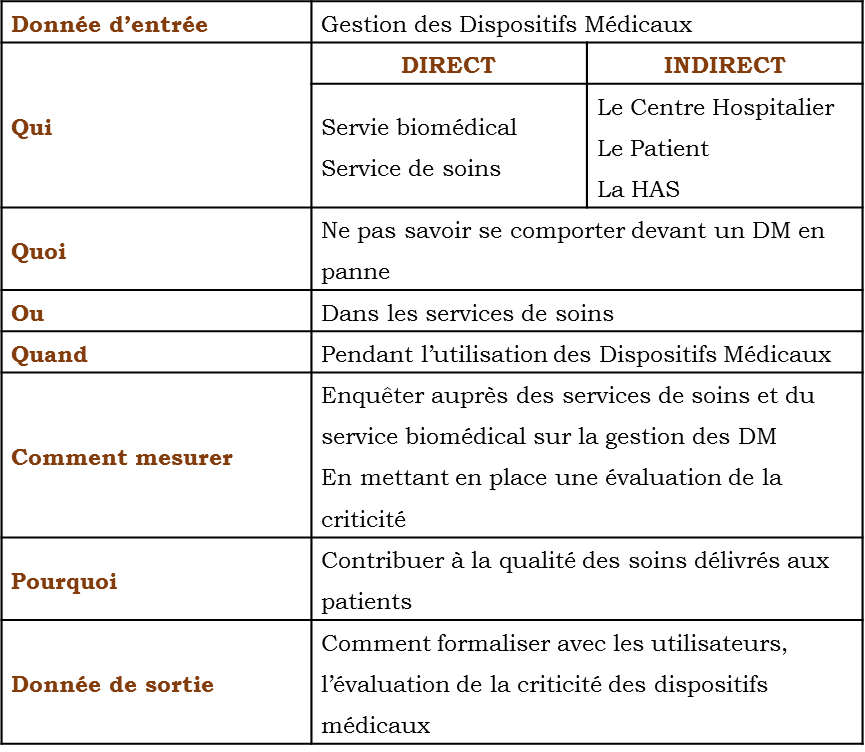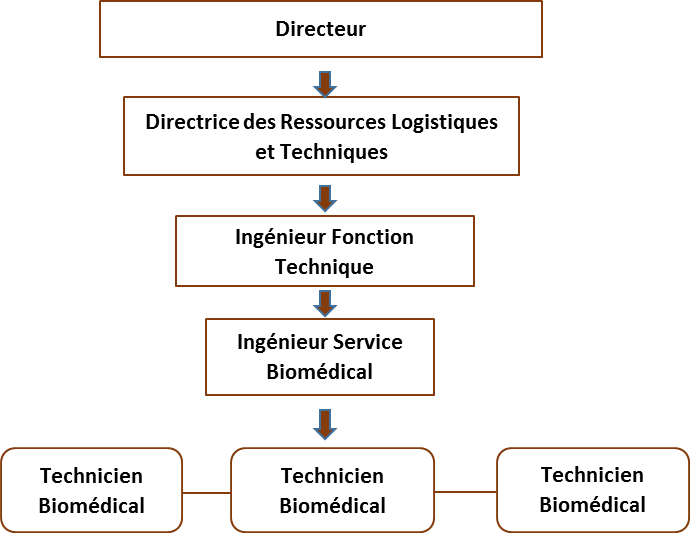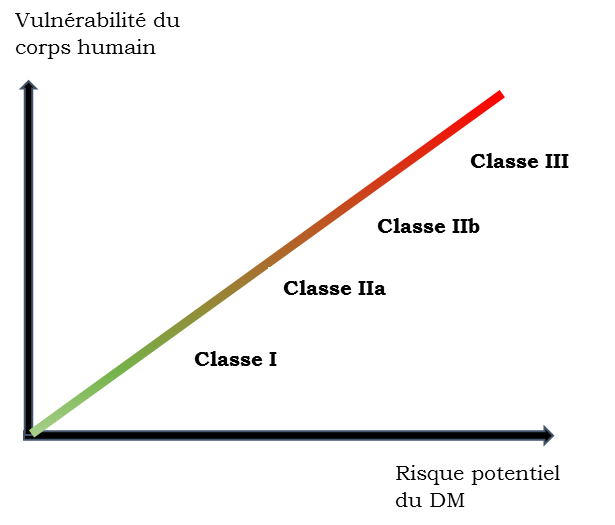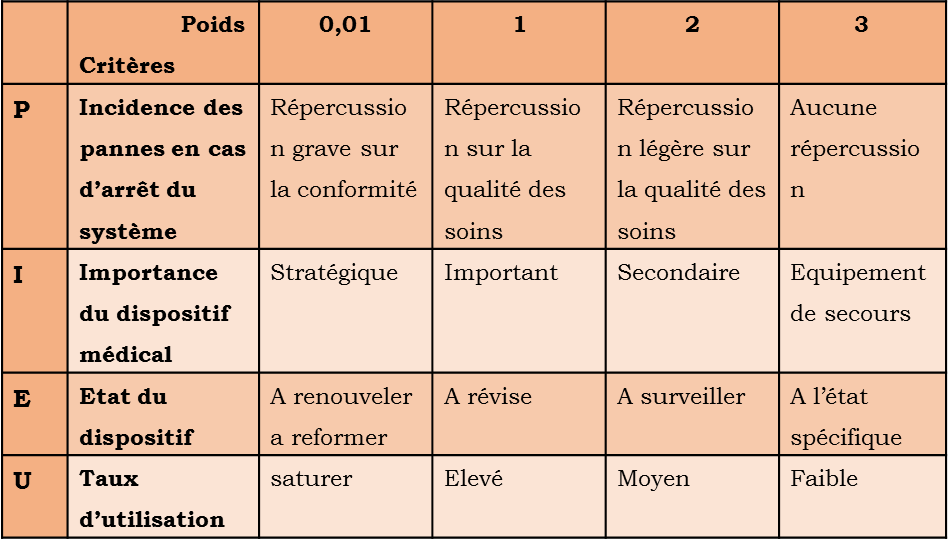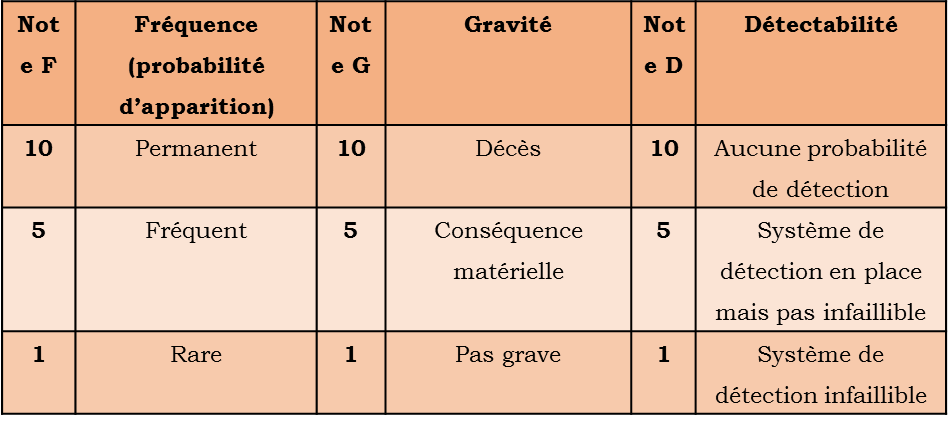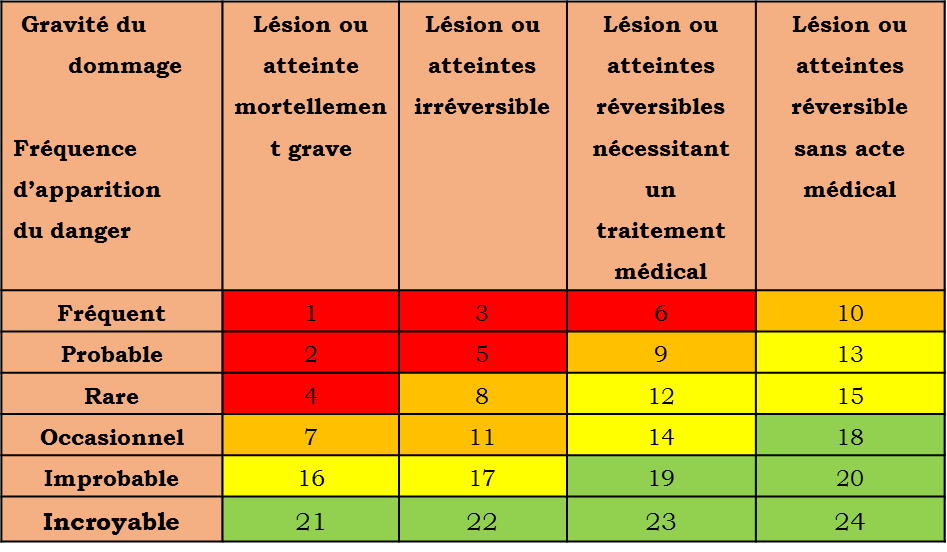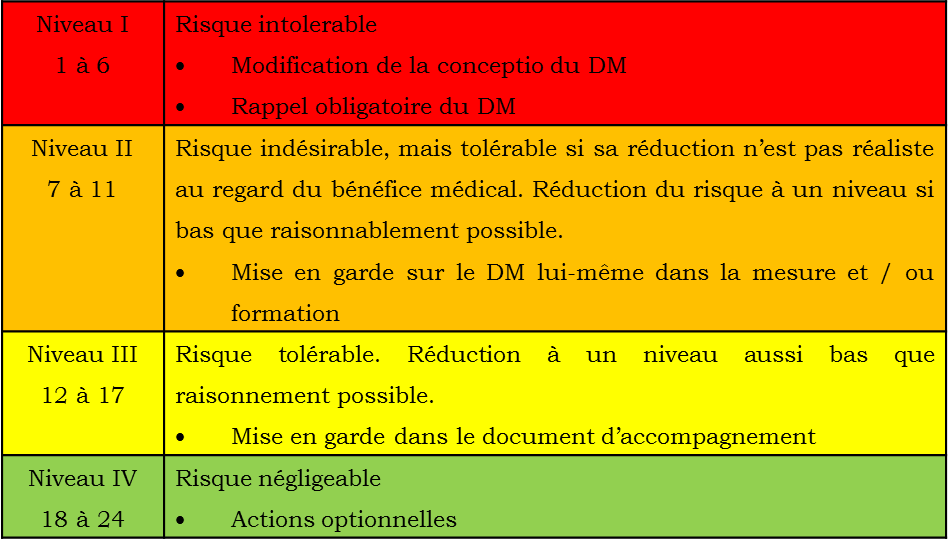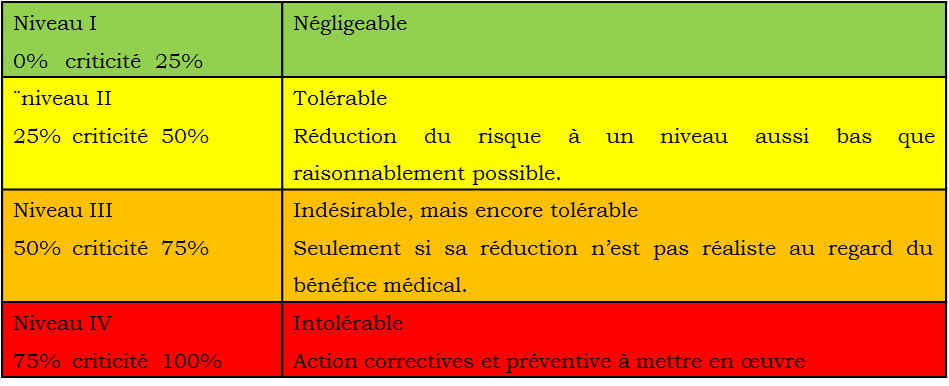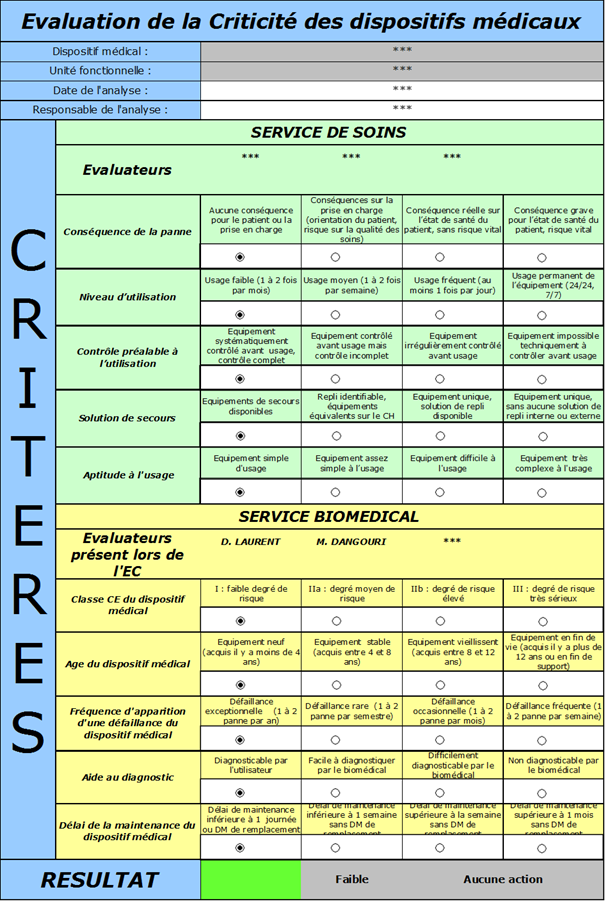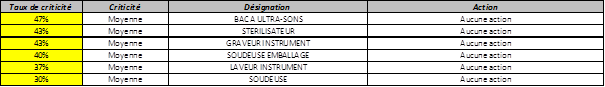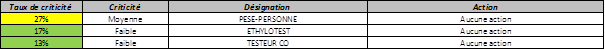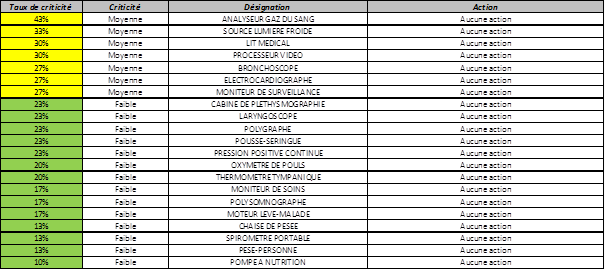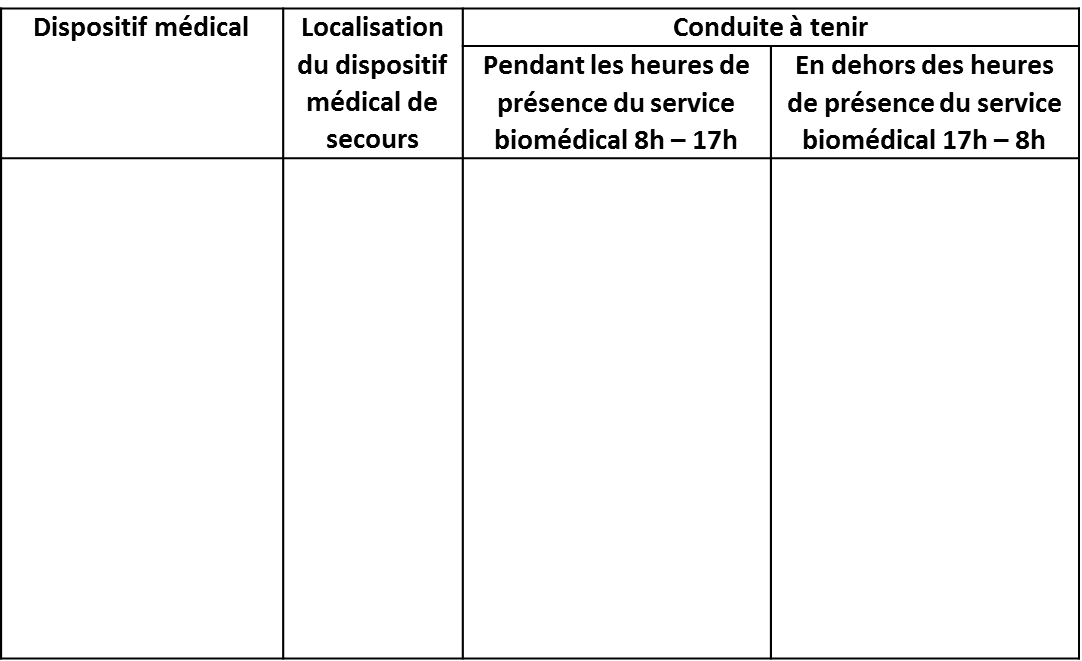|
Avertissement
|
Si vous arrivez
directement sur cette page, sachez que ce travail est
un rapport d'étudiants et doit être pris comme tel. Il
peut donc comporter des imperfections ou des
imprécisions que le lecteur doit admettre et donc
supporter. Il a été réalisé pendant la période de
formation et constitue avant-tout un travail de
compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse
sur des thématiques associées aux technologies
biomédicales. Nous ne
faisons aucun usage commercial et la duplication
est libre. Si vous avez des raisons de contester
ce droit d'usage, merci de
nous en faire part . L'objectif de la
présentation sur le Web est de permettre l'accès à
l'information et d'augmenter ainsi les échanges
professionnels. En cas d'usage du document, n'oubliez
pas de le citer comme source bibliographique. Bonne
lecture...
|
|
Evaluation de la criticité des dispositifs
médicaux d’un centre hospitalier et mise en place
de fiches de conduite à tenir en cas
d’indisponibilité
|

|

Aouporé Marc DANGOURI |

|
Référence à
rappeler : Evaluation de la criticité des
dispositifs médicaux d'un centre hospitalier et mise en
place de fiches de conduite à tenir en cas
d'indisponibilité,
Aouporé Marc DANGOURI, Stage,Certification
Professionnelle ABIH, UTC, 2016
URL : http://www.utc.fr/abih
; Université
de Technologie de Compiègne
|
Télécharger
le rapport
|
|
Télécharger le poster
|
|
RESUME
La gestion des dispositifs
médicaux dans un établissement de santé requiert une
attention particulière sur leur disponibilité et leur
fonctionnement, permettant ainsi d’assurer une
continuité des soins et une meilleure prise en charge du
patient. La criticité d’un dispositif médical est la
combinaison de la fréquence d’apparition d’une panne, de
la gravité de cette panne et la probabilité de détection
de la panne. La Méthode d’Analyse de la Criticité des
dispositifs médicaux en Exploitation (MACE) est utilisée
dans ce rapport pour l’évaluation de la criticité des
dispositifs médicaux du Centre Hospitalier
d’Alès-Cévennes. L’enjeu de connaitre le taux de
criticité des DM permettra, à terme, pour le patient, de
bénéficier de soins de qualité et continu en toute
sécurité. A la fin du stage, l’évaluation de la
criticité a été réalisée pour cinq services.
Mots clés : Evaluation, criticité, MACE, HAS
|
|
ABSTRACT
Médical devices management
in a healthcare facility requires special attention on
their availability and operation, thus ensuring
continuity of care and improved patient care. The
criticality of a medical device is the combination of
the frequency of occurrence of a failure, the severity
of the failure and the probability of detection of the
breakdown. The Method Criticality Analysis of medical
devices in operation (MACE) is used in this report to
evaluate the criticality of medical devices of
Alès-Cévennes hospital. The issues to know the médical
devices criticality rate will be, ultimatly,
for the patient to receive quality and continuous safely
care. At the end of the internship, the
criticality assessment was carried out for five care
services.
Key words : Assessment, criticality, MACE, HAS
|
Remerciements
Je tiens à remercier la Direction du Centre Hospitalier
Alès-Cévennes de m’avoir accepté au sein de son établissement pour
la réalisation de mon stage pratique.
Je remercie particulièrement David LAURENT, ingénieur biomédical,
responsable du service biomédical pour son engagement, son
accompagnement permanent et très instructif tout au long de mon
stage.
Mes remerciements vont également à l’attention de Fabrice CURBILE,
Julien BOURGUET et Nicolas TRANIER, techniciens biomédicaux, de
m’avoir permis d’apprendre de leurs connaissances pendant mon
stage.
A l’ensemble du personnel du CH Alès-Cévennes pour son accueil et
sa disponibilité, je dis merci.
Je remercie Gilbert FARGES, conseiller scientifique de la
formation ABIH, Pol-Manoël FELAN, responsable de la formation ABIH
et tout l’ensemble du corps professoral de la formation ABIH de
l’UTC pour leurs précieux enseignements, sans oublié Natalie
MOUTONNET, Assistante de la formation ABIH pour sa disponibilité
permanente.
Merci à ma famille et à mes amis du Burkina Faso de m’avoir
soutenu et permis d’effectuer cette formation.
Sommaire
RESUME
REMERCIEMENT
ABREVIATION
INTRODUCTION
I. ANALYSE
DE LA SITUATION
1. La problématique du projet
2. Les
enjeux de la criticité des DM
3. Le
Service Biomédical
a. Contexte règlementaire
b. Organisation de la
maintenance
c. Classes des
dispositifs médicaux
II. EVALUATION
DE LA CRITICITE
1. Définition de la criticité
2. Etat des
lieux
3. Objectif
du projet
a. Risques
du projet
b. Alternatives aux risques
4. Méthodologie utilisée pour
l’évaluation
a. Les méthodes
d’évaluation de la criticité
b. Choix et validation
de la méthode retenue
c. Méthodologie de mise
en place de l’évaluation
III. RESULTATS : BILAN ET
ANALYSE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
Annexe 1 :
Descriptif projet de l’EPP
Annexe 2 : Fiche
de suivi de réunion pour l’évaluation de la criticité
ABREVIATION
ABIH
Assistant Biomédical en Ingénierie Hospitalière
AMDEC Analyse des Mode de
défaillance de leurs Effets et de leur Criticité
CE
Conformité Européenne
CQ
Contrôle Qualité
CHAC Centre
Hospitalier Alès-Cévennes
DM
Dispositif Médical
EPP
Evaluation des Pratiques Professionnelle
GMAO Gestion de la
Maintenance Assisté par Ordinateur
HAS Haute
Autorité de Santé
MACE
Méthode d’Analyse de la Criticité des dispositifs médicaux en
Exploitation
QQOQCP Qui, Quoi, Ou, Quand, Comment,
Pourquoi
SBM
Service BioMédical
UTC
Université de Technologie de Compiègne
Introduction
Dans le cadre de mon projet de fin d’étude pour
l’obtention de la Certification Professionnelle « Assistant
Biomédical en Ingénierie Hospitalière » l’honneur m’a été donné
d’effectuer un stage au Centre Hospitalier Alès-Cévennes (CHAC).
La gestion des dispositifs médicaux dans un établissement de santé
requiert une attention particulière sur leur disponibilité et leur
bon fonctionnement, permettant ainsi d’assurer une continuité des
soins et une meilleure prise en charge du patient. La Haute
Autorité de Santé recommande aux établissements de santé d’avoir
une procédure (équipement de secours, solution dégradée ou
dépannage d’urgence) permettant de répondre à une panne d’un
équipement biomédical critique. Le CH Alès-Cévennes dispose de
plusieurs procédures mis en place pour répondre à cette
recommandation. Cependant, dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité, le CHAC, à travers le service biomédical,
souhaite évaluer la criticité de ses dispositifs médicaux. Dans le
but d’avoir des réponses à ce projet, le sujet suivant m’a été
soumis : « Evaluation de la criticité des dispositifs médicaux au
sein d’un centre hospitalier et mise en place de fiches de
conduite à tenir en cas d’indisponibilité ».
Le choix de ce sujet est dans la continuité de celui de Julien
BOURGET, promotion ABIH 2014, abordé lors de son stage au CHU de
Nîmes [2]. Le travail, au CH Alès-Cévennes, constitue à réaliser
l’évaluation de la criticité des dispositifs médicaux et à mettre
en place des fiches de conduite à tenir en cas d’indisponibilité
des DM jugés critiques.
Afin de présenter le travail réalisé, ce rapport est structuré en
trois parties. La première partie est consacrée à l’analyse de la
situation. La deuxième partie abordera l’évaluation de la
criticité. Enfin la troisième partie présentera les résultats
obtenus.
I.
ANALYSE DE LA SITUATION
Avec une capacité de 810 lits et places répartis sur
plusieurs sites dont 292 lits pour la MCO (Médecine Chirurgie
Obstétrique), 115 lits en Psychiatrie, 29 lits en SSR (Soins de
Suite et Réadaptation), et aussi plusieurs Maison De Retraite
(MDR), le CHAC couvre une population de 180 000 habitants. C’est
aussi plus de 1500 professionnels.
Le CHAC est organisé en huit pôles d’activités :
Le Pole Administratif, Logistique, Enseignement :
Direction Général, Direction Qualité et relation avec les Usager,
Direction des Ressources Humaines et de la Formation, Médecine de
Santé au Travail, Direction de l’Organisation des Soins, Direction
des Ressources Logistique et Techniques, Institut de Formation en
Soins Infirmiers.
Le Pole Génie Médical : l’imagerie médicale, le
laboratoire de biologie médical, la pharmacie, la stérilisation,
l’équipe d’hygiène, le département d’information médical, le
service social, les archives médicales.
Le Pole Soins Aigus : la réanimation, l’Unité de Soins
Continus, la cardiologie, l’Unité de Soins Intensif Cardiologique,
la pneumologie.
Le Pole Médecine : la médecine interne (médecine 1 et
2), le court séjour gériatrique, l’hôpital de jour gériatrique,
l’oncologie médical, l’hospitalisation programmée de médecine,
l’équipe mobile de gériatrie, l’équipe mobile de soins palliatifs,
l’équipe mobile d’addictologie de liaison.
Le pole Chirurgie Mère-Enfant : l’anesthésiologie, la
gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie générale et
digestive, la chirurgie orthopédique, la chirurgie ambulatoire, la
gastro-entérologie, les spécialités chirurgicales.
Le Pole Psychiatrie : la psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent, la psychiatrie de l’adulte
Le Pole Hébergement Personnes Agées : la résidence Lou
Cantou sur le site du CHAC, la résidence la Rose des Vents sur le
Rieu à Alès, la résidence les Camélias dans le centre-ville Alès,
la résidence les Cigales à Saint-Christol-les-Alès, la résidence
les Quatre saisons à Bagard, la résidence le Castellas, à Rousson.
Le Pole Urgence : l’accueil des urgences, l’Unité
d’Hospitalisation de Courte Durée, le Service Mobile d’Urgence et
de Réanimation.
retour sommaire
1.
La problématique du projet
Nous utiliserons l’outil QQOQCP pour identifier notre
problématique.
A l’issue de l’outil, la problématique apparue est : comment
formaliser avec les utilisateurs, l’évaluation de la criticité des
dispositifs médicaux.
retour sommaire
2.
Les enjeux de la criticité des DM
Les enjeux de la criticité des DM concernent autant les
établissements de santé, que les services de soins, le service
biomédical, les organes de veille et de règlementation (ANSM,
HAS…) et au final le patient.
Pour le patient
Bénéficier de soins de qualité et continu en toute sécurité.
Pour les services de soins
Savoir comment réagir en cas de panne des Dispositifs Médicaux
afin d’assurer la continuité de soins aux patients.
Pour le service biomédical
Améliorer l’efficacité du service en priorisant la maintenance
des DM critiques.
Etre en conformité vis-à-vis de la réglementation pour le critère
8k de la certification de la HAS.
Pour les établissements de santé
Assurer sa mission de service public. Suivre les recommandations
de la HAS.
Pour les organes de veilles et de réglementation
Avoir une visibilité de la qualité et de la gestion des DM.
retour sommaire
3. Le
Service Biomédical
Le service biomédical dépend depuis janvier 2005 de la fonction
technique, rattaché à la Direction des Ressources Logistiques et
Technique (DRTL). Cette dernière intègre le pole « Administratif,
Logistique et Enseignement » conformément à l’organisation de
l’établissement en pole d’activité.
Pour absorber une taille de plus en plus importante du parc,
l’organisation du travail entre technicien se répartie en «
famille » d’équipement médicaux. Chaque technicien est référant en
terme de campagne de maintenance préventive, corrective et de
contrôle qualité.
L’objectif de cette organisation est de maitriser l’état et les
fonctionnalités des dispositifs médicaux, de prolonger leur durée
de vie et d’optimiser la gestion du parc. Cela se traduit par
l’engagement, en matière de maintenance et de contrôle qualité,
d’organiser la prise en charge des dispositifs médicaux de manière
planifiée, pour garantir leur disponibilité dans des délais
raisonnables, compatible avec l’activité des services de soins, et
ce dans le respect des textes réglementaire, du contexte
économique et des projets du service.
Le service biomédical est situé dans le bâtiment MCO. Il comporte
2 bureau, 1 local pour le rangement des dispositifs volumineux, 1
local pour la réparation et le stockage des lits et 1 pièce
structurée en 5 zones d’activité :
- Envoie / Réception des colis
- Maintenance préventive et contrôle de qualité
- Pièces détachées et accessoires
- Point qualité (classeur, documentation)
a.
Contexte règlementaire
Depuis la création du service biomédical en 1998, l’organisation
qui a été mis en place à évolué afin d’être en phase avec la
règlementation en vigueur :
- Décret n° 95-292 du 16 mars relatif au marquage CE
- Arrêté du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité anesthésique
- Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la
matériovigilance
- Ordonnance du 24 avril 1996 relatif à l’accréditation
- Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à a la bonne exécution des
analyses de biologie médical (GBEA) modifié par l’arrête du 26
avril 2002
- Arrêté du 25 avril 2000 relatif à la sécurité obstétricale et
de néonatologie
- Décret n° 2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l’obligation
de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs
médicaux
- Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs
médicaux soumis à obligation de maintenance
- Mise au point sur la maintenance des dispositifs médicaux
(octobre 2012-Afssaps)
b.
Organisation de la maintenance
La maintenance corrective et préventive, le contrôle qualité
sont réalisé en interne par les techniciens biomédicaux dans la
limite de leur compétence ou habilitation. Dans le cas contraire,
la maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa
responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance.
La commande de pièces détachées et les demandes d’intervention
auprès des sociétés extérieures sont faites par les techniciens
biomédicaux. Elles sont ensuite transmises à la gestionnaire de la
DRLT qui fait valider par la Direction.
Le SBM dispose d’une GMAO (SYSBIO). Ce logiciel permet d’avoir une
traçabilité :
- Des demandes d’interventions
- Des rapports d’intervention
- De l’inventaire du matériel médical actif ou reformé
La GMAO SYSBIO est couplé à une messagerie informatisé WEBDI qui
permet de recevoir, de valider et de traiter les demandes
d’interventions formulées par les services de soins. Les demandes
sont également effectuées par le téléphone selon l’urgence mais
doit être régularisé par une demande en ligne.
retour sommaire
c.
Classes des dispositifs médicaux
Les dispositifs médicaux sont repartis en quatre classes
correspondant à des niveaux de risque. Cette détermination est
élaborée selon la directive européenne 93/42/CEE.
Classe I : faible degré de risque
Classe IIa : degré moyen de risque
Classe IIb : degrés de risque élevé
Classe III : degrés de risque très élever
II.
EVALUATION DE LA CRITICITE
1.
Définition de la criticité
Selon la définition normée NF EN 60812, la criticité d’une
défaillance est la combinaison d’un effet et de l’occurrence de
son apparition, ou d’autres attributs d’une défaillance comme une
mesure de la nécessité de mise en place (ou en œuvre) de mesures
préventives, ou correctives.
La criticité d’un DM est la combinaison de la fréquence
d’apparition d’une panne, de la gravité de cette panne et la
probabilité de détection de la panne.
Aspects normatif et réglementaire
Critère 8.k
du manuel de certification des établissements de santé [3]
Relatif a la gestion des equipements.
Décret
2001-1154 du 5 décembre 2001 [11]
Relatif à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité des
dispositifs médicaux prévu à l’article L.5212-1 du code de la santé
publique.
NF S 99-170 [13]
Relatif à la maintenance des dispositifs médicaux, du système de
management de la qualité pour la maintenance et la gestion des
risques associés à l’exploitation des dispositifs médicaux.
NF S 99-172 [14]
Relatif à l’exploitation des dispositifs médicaux, à la gestion des
risques liés à l’exploitation des dispositifs médicaux dans les
établissements de santé.
NF EN ISO 14971 [15]
Relatif aux dispositifs médicaux, à l’application de la gestion des
risques aux dispositifs médicaux.
NF EN 31010 [16]
Relatif à la gestion des risques et aux techniques d’évaluation des
risques.
NF ISO 31000 [17]
Relatif au management du risque et aux principes et lignes
directrices.
NF EN 60812 [18]
Relative aux techniques d’analyses de la fiabilité du système, de la
procédure d’analyse des modes de défaillance et de leurs effets.
2. Etat des
lieux
Mon projet se base sur la méthode d’évaluation de Julien
BOURGUET, promotion ABIH 2014, utilisé pendant son stage au CHU de
Nîmes.
Le service biomédical a également mis en place plusieurs documents
d’organisation de la maintenance du service :
- Une fiche d’organisation de la maintenance et des contrôles
de qualité
- Un mode opératoire de conduite à tenir en cas de panne d’un
DM avec comme indicateur : le service concerné, le DM, la
conduite à tenir pendant les heures de présence du SBM (8h-17h)
et en dehors des heures de présence du SBM (17h-8h et le
weekend).
D’autres documents viennent s’ajouter, mais nous nous
intéresseront à celui du mode opératoire de conduite à tenir en
cas de panne. En effet, celui-ci s’approche de près à la procédure
exigée par la HAS.
Cependant il n’est pas utilisé du fait qu’il n’a pas suivi le
processus d’élaboration et de validation institutionnel.
3.
Objectif du projet
Le projet consiste en l’évaluation de la criticité pour
l’ensemble des DM du CH Alès-Cévennes et la mise en place de
fiches de conduite à tenir en cas d’indisponibilité pour les DM
les plus critiques identifiés. Cette fiche permettra aux services
de soins d’assurer la continuité des soins lors des
disfonctionnements constatés pendant l’utilisation des DM.
a.
Risques du projet
Tout projet que l’on souhaite mettre en place comporte des
risques. Les risques que nous pourrons rencontrer sont :
- la non validation par la cellule qualité sur la forme ;
- la confusion par les services de soins entre la criticité du
dispositif médical lié à sa panne et le risque encouru par le
patient pendant l’utilisation du DM ;
- le temps prévu pour la mise en place du projet insuffisant ;
b.
Alternatives aux risques
Afin d’anticiper ces risques nous allons échanger avec la
cellule qualité sur la forme de l’évaluation, notamment pour
s’insérer dans le cadre institutionnel.
Avec les services de soins nous tacherons d’expliquer le but et la
finalisation de l’évaluation qui est de leur permettre d’avoir des
équipements performent et une disponibilité maximale.
Pour le temps nous mettrons en place un planning opérationnel que
nous tachetons de respecter.
Nous vérifierons et mettrons à jour la GMAO
retour sommaire
4.
Méthodologie utilisée pour l’évaluation
a.
Les méthodes d’évaluation de la criticité
La méthode PIEU
Utilisé par les exploitants de DM car elle est perçue comme
simple à mettre en œuvre, elle estime la criticité en multipliant
quatre paramètres sur quatre niveaux d’évaluation.
P : indice des Pannes
I : Importance de l’équipement
E : Etat de l’équipement
U : taux d’Utilisation de l’équipement
C = P * I * E * U
Avec la méthode PIEU, plus la valeur de la criticité est petite,
plus le DM est critique. Ainsi la méthode induit un ordre
inversement proportionnel entre la dangerosité de la criticité et
sa valeur exprimée.
La méthode AMDEC
Les critères d’évaluation définis par l’Analyse de Défaillance
de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC) sont : la gravité de
la panne de l’équipement en termes de risque pour la santé du
patient, la fréquence d’apparition de la panne et la détectabilité
de la panne.
retour sommaire
La méthode matrice Gravité/Fréquence
Cette méthode prend en compte la gravité du dommage et la
fréquence d’apparition de la panne ou danger. En fonction de ces
deux critères et en croisant les incidences sur une matrice, on
obtient le résultat.
Ce résultat est ensuite analysé en fonction des niveaux de
criticité, avec quatre niveaux de détermination.
retour sommaire
La méthode MACE
La Méthode d’Analyse de la Criticité des dispositifs médicaux en
Exploitation (MACE) a été mis en place par des étudiants en Master
de Technologie et Territoire de Santé de l’Université de
Technologie de Compiègne en 2012. L’outil d’évaluation est conçu
sous Excel et prend en compte les utilisateurs et le service
biomédical. La méthode utilise cinq critères d’évaluations pour
les utilisateurs :
- Fréquence d'utilisation du dispositif médical
- Usage fait du dispositif médical (compétence du personnel,
dangerosité de l’acte médical, ergonomie d’utilisation
- Valeur technique (plus-value, vétusté fonctionnelle) du
dispositif médical
- Dépendance du dispositif médical à un défaut de
l’environnement technique
- Gravité des pannes en cas d’arrêt du dispositif médical,
Et cinq critères d’évaluation pour le service biomédical :
- Classe CE du dispositif médical
- Vétusté du dispositif médical (fréquence d’usage, âge,
condition d’emploi
- Fréquence d’apparition d’une défaillance du dispositif
médical ou de son environnement technique.
- Détectabilité de la panne du dispositif médical, ou de son
environnement technique.
- Délai de maintenance du dispositif médical, ou de son
environnement technique
retour sommaire
b.
Choix et validation de la méthode retenue
Choix de la méthode
Parmi toutes ces méthodes, celle que nous utiliserons pour
l’évaluation de la criticité est la méthode MACE. Les raisons de
ce choix sont qu’elle a été validée par l’Université de
Technologie de Compiègne, reconnu par la communauté biomédicale à
travers la publication dans des revues spécialisées, elle a été
utilisée par le CH de Charleville-Mézières, le CHU de Nîmes. Cette
méthode a l’avantage d’être facile à mettre en place et prend en
compte aussi bien l’avis du service biomédical que celui des
utilisateurs. Les critères de la fiche d’évaluation sont les mêmes
critères que ceux utilisés par le CHU de Nîmes. La figure
ci-dessous donne l’exemple d’une fiche d’évaluation pour une
famille d’équipement.
Validation de la méthode
Pour la validation de la méthode retenue, nous avons rencontré
la cellule qualité pour expliquer notre démarche. Elle y adhère et
nous a encouragé à mener l’activité dans la procédure des
Evaluations des Pratique Professionnelles (EPP) afin d’avoir une
visibilité au sein du CHAC. (Annexe 1)
L’EPP est définie comme :
- L’analyse de la pratique professionnelle en référence à des
recommandations.
- Selon une méthode validée comportant la mise en œuvre et le
suivi d’action d’amélioration.
Les facteurs important de l’évaluation des pratiques
professionnelles sont :
- L’engagement de la direction, de l’encadrement, des
professionnels.
- L’obligation de faire des points réguliers de l’avancement du
projet EPP.
- La valorisation des résultats et communication (avant,
pendant et après).
c.
Méthodologie de mise en place de l’évaluation
Mise à jour de la GMAO
Nous avons fait une mise jour des équipements et des services
qui figurent dans la GMAO, afin de prendre en compte tous les
équipements et services qui ne figuraient pas dans la GMAO. Nous
avons ensuite extrait les équipements sous Excel. Ce fichier nous
a servi de base de travail pour mettre en place les familles
d’équipement par service.
Développement des outils
Nous avons mis en place une macro basée sur le fichier Excel
précédemment mise en place. Celle-ci permet de créer
automatiquement autant de fiches d’évaluation par service et par
famille d’équipement. La fiche de résultat classe automatiquement
les équipements à taux de criticité élevés en première position.
Elle permet également de faire l’exportation des résultats en PDF.
Création des outils
Après avoir testé que les outils fonctionnaient correctement,
nous avons procédé à leur création.
Planification des réunions d’évaluation
L’identification des différents responsables de service et
cadres de santé s’avariait nécessaire pour la planification des
réunions. Nous avons donc mis en place une fiche de suivi sur
laquelle figure tous les services et les cordonnées (mail,
téléphone) de ces personnes (annexe 2).
Nous avons ensuite envoyé des mails à tous les services concernés.
Dans le mail nous expliquons le sens de la démarche, nous donnons
les membres attendus à la réunion d’évaluation qui sont :
- Le médecin responsable du service
- Eventuellement un ou plusieurs utilisateurs
- Le technicien biomédical référent
Aussi nous demandons une date de rencontre en tenant compte de
la fin du stage selon leur disponibilité. Dans le cas contraire,
l’évaluation sera tout de même menée par le service biomédical.
Réalisation des réunions
Après réception des premières réponses, nous mettons en place un
programme de réalisation des réunions de commun accord avec les
services concernés. La réunion a débuté par la stérilisation et la
pharmacie. L’addictologie, la pneumologie, et l’équipe mobile de
soins palliatif sont les services qui ont suivis. En préambule des
réunions, nous expliquons toujours le sens de la démarche de
l’évaluation de la criticité des DM et nous présentons l’outil qui
servira à l’évaluation.
retour sommaire
III.
RESULTATS : BILAN ET ANALYSE
Sur l’ensemble des quarante-deux services prévu, cinq ont été
évalué à la fin du stage. Il s’agit de la pharmacie, de la
stérilisation, de l’addictologie, de la pneumologie et de l’équipe
mobile de soins palliatifs.
Ce qui fait un taux de réalisation d’environ 12%. Faible pour un
objectif qui était de 100%. Le taux de réalisation est faible à
cause du temps prévu pour le stage, de la disponibilité des
services de soins.
Pharmacie
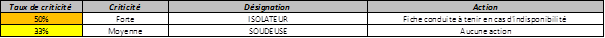
Stérilisation
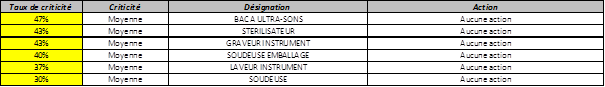
Addictologie
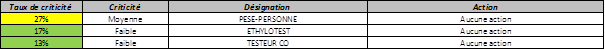
Pneumologie
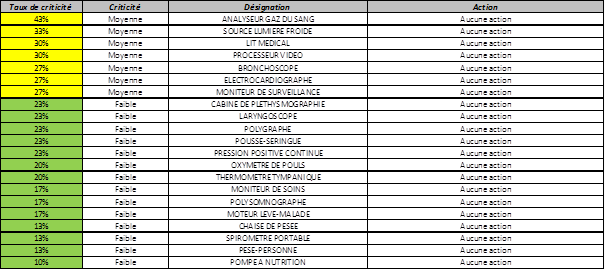
Equipe mobile de soins palliatif
L’analyse que nous faisons de ces résultats est que sur
l’ensemble des services évalué, seul le service de pharmacie
contient une famille d’équipement a taux de criticité égale ou
supérieur à 50%. Cela est dû au fait que les services communément
« critique », tel que la Réanimation, les Urgences ou l’Imagerie
n’ont pas été encore évalués.
Fiche de conduite à
tenir
Pour tout équipement ou famille d’équipement qui a un taux de
criticité égale ou supérieur à 50%, une fiche de conduite à tenir
doit être faite pour les utilisateurs. La mise en place de ces
fiches devait suivre à la fin de l’évaluation de la criticité.
Compte tenu du fait qu’elle n’est pas fini, aucune fiche n’a été
faite. Cependant un canevas de fiche de conduite à tenir en cas
d’indisponibilité a été mise en place. Le contenu sera adapté en
fonction du dispositif médical.
retour sommaire
CONCLUSION
Le problématique identifié au début de ce rapport était :
comment formaliser avec les utilisateurs, l’évaluation de la
criticité des dispositifs médicaux. Nous espérons avoir répondu à
cette problématique avec la méthode MACE.
Nous avons prévu d’évaluer tous les équipements préalablement
identifié de tous les services du CH Alès-Cévennes. Cela ne sera
possible pour notre part compte tenu du temps imparti à notre
stage. Vu l’engagement du service biomédical et de l’inscription
de l’évaluation de la criticité en Evaluation des Pratiques
Professionnelles, elle tirera à sa fin.
Notre souhait est que l’évaluation de la criticité puisse être
intégré à la GMAO afin d’automatiser l’évaluation par le biais des
renseignements liés notamment aux demandes d’interventions, aux
nouvelles acquisitions et toutes autres informations nécessaire au
renseignement de l’évaluation de la criticité.
Bilan personnel
Le bon accueil reçu au CH Alès-Cévennes, m’a permis d’être en
confiance pour la réalisation de mon stage pratique. J’ai eu la
chance de mener des activités de maintenance préventive et
corrective dans les différents services de l’hôpital avec l’appui
des techniciens biomédicaux.
L’évaluation de la criticité de dispositifs médicaux est un sujet
intéressant qui m’a permis de mettre en pratique les méthodes de
managements de projet appris lors de la formation théorique à
l’UTC.
L’évaluation de la criticité a aussi été bien accueillie dans les
services de soins où nous sommes passés.
Dans l’ensemble, ce stage m’a permis de mettre en pratique les
connaissances acquises lors de la session théorique, de connaitre
le fonctionnement du service biomédical et de me familiariser avec
l’activité hospitalière française.
BIBLIOGRAPHIE
[1] Site du centre hospitalier Alès-Cévennes www.ch-ales.fr (avril
2016)
[2] Evaluation de la criticité des dispositifs
médicaux du CHU de Nîmes http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/14/stage/bourguet/bourguet/index.html
(mai 2016)
[3] Manuel de certification des établissements de
santé, révision janvier 20014. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-03/manuel_v2010_janvier2014.pdf
(mai 2016)
[4] Nouvelle Méthode pour l’Analyse de la
Criticité de dispositifs médicaux en Exploitation (2012) http://www.utc.fr/~mastermq/public/publications/qualite_et_management/MQ_M2/2012-2013/MIM_projets/qpo12_2013_gr6_Criticite_DM/MIM_criticite_DM_v6.pdf
(mai 2016)
[5] Analyse de la criticité pour l’optimisation
des ressources biomédicales
http://www.utc.fr/~farges/dess_tbh/98-99/Projets/ACORB/acorb.htm
(mai 2016)
[6] Gestion de la criticité des dispositifs
médicaux du centre hospitalier de Calais
http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/13/stage/castelain/
(mai 2016)
[7] Méthode d’évaluation pour les projets d’appui
à l’équipement médical des structures de santé des pays en
développement
http://www.urd.org/IMG/pdf/Methode_EVALUATION.pdf (mai 2016)
[8] La criticité des équipements
http://fr.slideshare.net/sergemathieu/mod-form-criticite
(mai 2016)
[9] Evaluation des besoins en dispositifs médicaux
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21562fr/s21562fr.pdf
(mai 2016)
[10] La méthodologie AMDEC http://crta.fr/wp-content/uploads/2013/10/04-M%C3%A9thode-AMDEC.pdf
(mai 2016)
[11] Décret n°2001-1154 du 5
décembre 2001 relatif à l’obligation de maintenance et au
contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévu à l’article L.
5212-1 du code de la santé publique. www.legifrance.gouv.fr (mai
2016)
[12] Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des
dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au
contrôle qualité mentionnés aux articles L. 5211-1 et D. 665-5-3
du code de la santé publique. www.legifrance.gouv.fr (mai 2016)
[13] NF S99-170 (2003-05-17) Maintenance
des dispositifs médicaux – Système de management de la qualité
pour la maintenance et la gestion des risques associés à
l’exploitation des dispositifs médicaux. www.sagaweb.org (mai
2016)
[14] NF S99-172 (2003-09-01)
exploitation des dispositifs médicaux – Gestion des risques lié à
l’exploitation des dispositifs médicaux dans les établissements de
santé. www.sagaweb.org (mai 2016)
[15] NF EN ISO 14971 (2013-01-05)
Dispositif médicaux – Application de la gestion des risques
au dispositif médicaux. www.sagaweb.org (mai 2016)
[16] NF EN 31010 (2010-07-01)
Gestion des risques – Techniques d’évaluations des risques.
www.sagaweb.org (mai 2016)
[17] NF 3100 (2010-01-01) Management
du risque – Techniques d’évaluations des risques. www.sagaweb.org
(mai 2016)
[18] NF EN 60812 (2006-08-01)
Technique d’analyse de la fiabilité du système – Procédure
d’analyse des modes de défaillance et de leur effet (AMDE).
www.sagaweb.org (mai 2016)
ANNEXES
liste des figures:
figure 1: Carte de couverture
sanitaire
Figure
2: Tableau QQOQCP
figure 3: Organigramme service
biomédical
Figure 4: Tableau méthode PIEU
Figure
5: Tableau AMDEC
Figure 6: Matrice Gravité/fréquence
Figure 7: Tableau des niveaux de la
méthode Gravité/fréquence
Figure 8: Tableau de niveau de la méthode
MACE
Figure 9: Fiche d'évaluation d'une
famille d'équipement
Figure 10: Fiche de conduite à tenir
retour sommaire